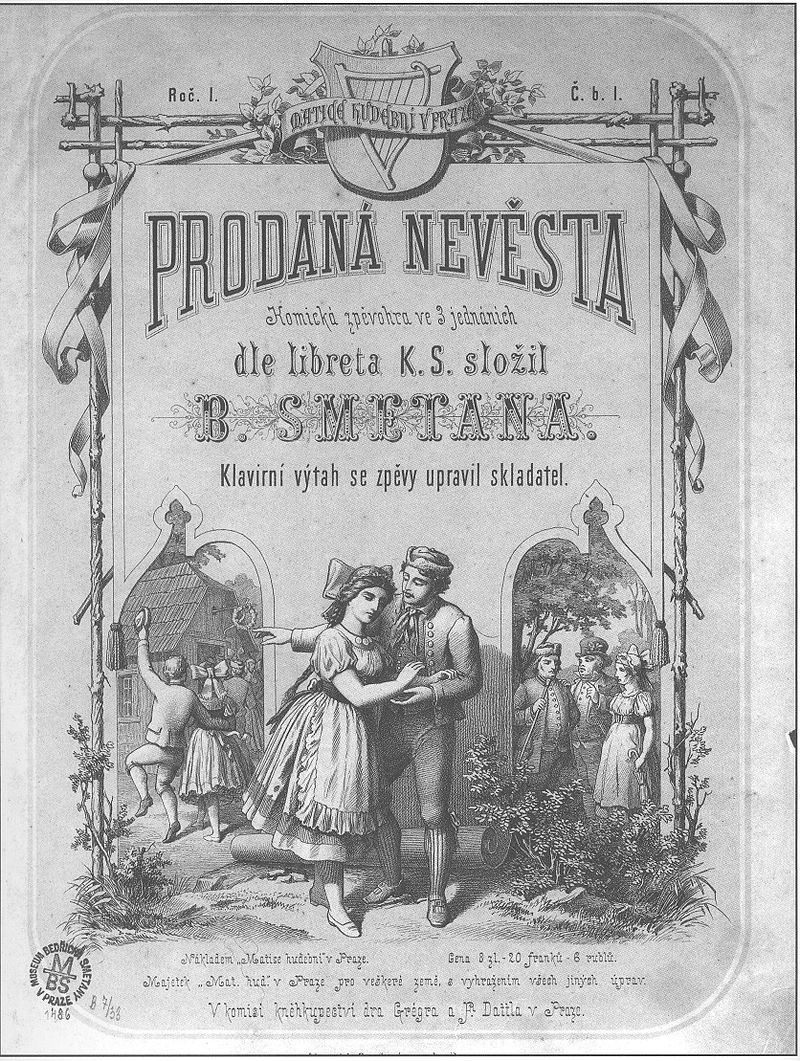Le 5 juin 1981, les médecins du Centers for Disease Control des Etats-Unis constatent que cinq homosexuels de Los Angeles souffrent d'une déficience du système immunitaire, jusque-là inconnue. (1) Les personnes sont affectées de maladies rares telles la pneumocystose et le sarcome de Kaposi, une forme de cancer de la peau, deux pathologies favorisées par l'effondrement des défenses immunitaires. On ignore alors les causes et la gravité d'une maladie que l'on nommera en 1982 Sida, pour syndrome d'immunodéficience acquise (AIDS en anglais).
_-_2022-10-11_-_1.jpg/992px-Plaque_Place_Combattantes_Combattants_Sida_-_Paris_IV_(FR75)_-_2022-10-11_-_1.jpg?20221011193750) |
| Chabe01, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
Après les victoires obtenues au cours de la décennie 1970 (2), les quartiers homosexuels de San Francisco ou New York revendiquent une liberté sexuelle totale. Dans les BackRooms, les pièces arrières des bars et des boîtes gays, les saunas et bains publics, il devient possible d'avoir des relations sexuelles avec de parfaits inconnus. Ces pratiques à risques favorisent la diffusion de la maladie.
Parmi les premières victimes du sida se trouvent les DJs et acteurs du monde des clubs disco. Le producteur Patrick Cowley succombe ainsi dès 1982. Il était derrière les tubes disco de Sylvester: "You make me feel mighty real" ou "Do you wanna funk?" Six ans après la disparition de son mentor, le chanteur le suit dans la tombe, lui aussi terrassé par le Sida. Dans "le langage perdu des grues", le romancier David Leavitt dépeint cette période comme "une époque où les rues étaient envahies par un sentiment de deuil et de panique quasi palpable."
Un puissant courant conservateur s'empresse de dénoncer les lieux fréquentés par les homosexuels comme de nouvelles Sodome et Gomorrhe. La propagation du sida au sein des communautés gays est considéré par les bigots comme un châtiment divin s'abattant sur des groupes immoraux et tarés. Or, comme dans un premier temps, le mal semble cantonné à la communauté homosexuelle, l'administration Reagan ne prend pas au sérieux une maladie que certains désignent comme un "cancer gay".
La
méconnaissance des causes et des modes de transmission de la maladie
fait souffler un vent de panique et alimente la machine à fantasmes. Certains accusent les homos
de transmettre délibérément le virus. Les malades sont traités comme des
parias par
ceux qui redoutent le simple contact avec un séropositif. Un
réflexe d'ostracisation se met en place. En Allemagne, la CSU, le parti
social chrétien de Bavière préconise l'enferment des malades. En France,
Jean-Marie Le Pen propose une politique ségrégationniste à l'encontre
de ceux qu'il désigne comme des "sidaïques" à enfermer dans des
"sidatoriums".
D'aucuns se persuadent que l'on peut être contaminé en touchant un
malade, en buvant dans son verre, en étant piqué par un moustique ou en s'asseyant sur les lunettes des toilettes. En réalité, la transmission ne peut se faire que de la mère à l'enfant, par
contact sexuel, par échange de seringues ou transfusion sanguine.
En 1989, avec "Halloween parade", Lou Reed propose une description d'un défilé s'apparentant à la Gay Pride. Il y mentionne les absents, emportés prématurément par le sida, mais aussi les conséquences sociales dramatiques de la maladie et l'homophobie rampante qu'elle alimente dans le New York des années 1980.
Constatant une prévalence de la maladie chez les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et les Haïtiens (l'île est devenu le lupanar des gays américains), des épidémiologistes nord-américains forgent la théorie des quatre H (Héroïnomanes, Haïtiens, Homosexuels, Hémophiles). En se focalisant sur ces groupes "à risques", ils contribuent à faire du Sida "une épidémie des marges". La maladie se répand pourtant très vite et l'on découvre qu'une transmission hétérosexuelle se développe simultanément en Afrique.
En 1983, avec l'aide de l'infectiologue Willy Rosenbaum, Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Cherman, membres de l'équipe de l'Institut Pasteur de Luc Montagnier (3) identifient le virus responsable du Sida (intitulé LAV), dont on découvre qu'il se transmet par le sperme et le sang. En 1986, l'appellation VIH, Virus de l'Immunodéficience humaine, s'impose. La découverte passe inaperçue auprès du grand public, mais suscite un immense espoir chez les malades, dont l'espérance de vie s'avère alors très faible: entre trois et six mois pour les patients immuno-déficients. (4) Pour beaucoup, la nouvelle du diagnostique entraîne l'angoisse d'une transmission possible des proches et une culpabilité immense.
En février 1988, alors que la pandémie bat son plein, Leonard Cohen chante dans un des couplets d'"Everybody knows": "Tout le monde sait que la peste arrive / Tout le monde sait qu'elle avance vite / Tout le monde sait que l'homme et la femme nus / Ne sont qu'une œuvre d'art du passé / Tout le monde sait que la scène est morte / Mais il y aura un compteur sur ton lit / Qui révélera ce que tout le monde sait".
Des avancées significatives interviennent. Des tests de dépistage sont élaborés et bientôt commercialisés. L'AZT, molécule antivirale, permet de retarder l'échéance fatale, mais le traitement médicamenteux est très cher et ses effets secondaires lourds. Au total, à la fin des années 1980, il n'existe toujours de traitement efficace contre le Sida. En 1987, l'ONU vote une résolution visant à unir les pays membres dans la lutte contre le sida, pourtant l'épidémie reste largement invisible pour les pouvoirs publics et dans la société. Alors que le nombre de victimes croît de façon exponentielle, passant de 200 victimes en 1984 à 1200 deux ans plus tard, aucune politique publique de prévention ou de dépistage n'est envisagée. Le climat de suspicion et de peur ne faiblit pas. De folles rumeurs circulent sur l'origine de la maladie ou sa transmission. (Pour anéantir la rumeur qui la prétend malade, Adjani doit démentir en direct au JT). Dans le milieu médical, les réactions face à la maladie sont parfois très violentes. Une psychose ambiante s'installe, au point que certains praticiens refusent d'accueillir des malades.
En 1993, Mano Solo interprète "Pas du gâteau", une chanson sur l'irrépressible envie de vivre, malgré la maladie. (« Mais c’est là que t’as dit / Qu’la vie c’est pas du gâteau / Et qu’on fera pas de vieux os / On fera pas d’marmots / Pour leur gueuler tout haut / Qu’la vie c’est pas du gâteau / Même si je gagne pas ma vie / Et même si j’ai le SIDA/ Moi ça m’coupe pas l’envie / Moi j’me dis pourquoi pas ».
Face à la l'impuissance initiale des médecins, les associations de soutien aux malades, souvent constituées de personnes atteintes du Sida, vont jouer un rôle crucial. Il s'agit d'une grande nouveauté, car ce sont elles qui fournissent un retour sur les stratégies thérapeutiques et participent aux protocoles de recherche. En 1984, Aides est fondé par
Daniel Defert, juste après la disparition du sida de son compagnon
Michel Foucault. L'association, qui se veut pragmatique et modérée, propose une écoute et un soutien aux malades, tout en menant une politique de prévention. En juin 1987, Larry Kramer comprend que les malades doivent se débrouiller seuls, sans pouvoir compter que sur le président Reagan. Il fonde Act up, un groupe militant qui
dénonce des États meurtriers n'investissant pas suffisamment dans la
recherche médicale. Act Up Paris est créé en 1989. L'association, dont les réunions sont ouvertes à tous, prône un militantisme radical et use de méthodes offensives comme les zaps, càd une action éclair contre une personne ou une organisation ou les die in, simulation de la mort en se couchant silencieusement au sol. (5) Il s'agit de s'imposer et d'utiliser les médias, en contrôlant sa communication et en changeant l'image du séropositif. Pour l'association, vaincre le sida est une question de volonté politique. Pour les membres, l'activisme sert d'exutoire collectif et de créer un réseau de solidarités face aux deuils à répétition.
Les malades meurent seuls, officiellement du cancer, tant il est alors tabou de se dire atteint du sida. L'acteur Rock Hudson est la première star à déclarer sa séropositivité en 1985, un nom sur la longue liste des célébrités emportées par le Sida: Rodolf Noureiev, Cyril Collard, Miles Davis, Klaus Nomi, Bruno Carette, Fela Kuti.... Freddie Mercury signe ses adieux en musique avec "The show most go on", un titre publié un mois avant sa mort. Se sachant atteint du sida dès 1985, le chanteur de Queen avait caché à ses proches la maladie, dont il reconnaît officiellement souffrir la veille de sa disparition, le 24 novembre 1991. Il chante: " A l’intérieur mon coeur est en train de se briser / Mon maquillage est peut-être en train de s’écailler / Mais mon sourire reste encore".
La mort de ces célébrité contribue par ricochet à mobiliser les milieux artistiques. En soutien aux associations de lutte contre le Sida, musiciens et chanteurs s'engagent, reversant par exemple les droits de chansons ou les recettes de concerts. Aux Etats-Unis, très affectées par la disparition de proches, Elizabeth Taylor, puis Madonna mobilisent leurs contacts. (6) En 1985, Line Renaud et Dalida organisent un gala au Paradis Latin pour lever des fonds. (7) Barbara écrit "Sid'amour" en 1987. Jamais enregistrée en studio, elle ne l'interprète qu'en concert, au cours desquels elle fait distribuer des préservatifs. Disponible, attentive, elle ne cessera d'apporter une aide active et discrète aux malades. « Ô Sida, Sid’assassin qui a mis l’Amour à mort »
Les politiques restent à la traînent et semblent dans un premier temps dépassés. Helmut Khol, François Mitterrand ne parlent pas du Sida. En France, la situation évolue avec Michèle Barzach. La ministre de la santé du gouvernement Chirac adopte des positions courageuses et mène une politique volontariste de prévention. Il devient possible de faire des campagnes de pub en faveur du préservatif et de vendre des seringues à usage unique dans les pharmacies. Cette mesure contribue à la chute des transmissions chez les toxicomanes. En Allemagne, la ministre de la santé Rita Süssmuth prône une politique fondée sur l'information et non sur l'exclusion. Aux Etats-Unis, en revanche, Ronald Reagan prône l'abstinence. Quant au pape Jean-Paul continue de condamner l'usage du préservatif.
Pour contrer les bigots obscurantistes, le groupe de r'n'b américain TLC transforme le préservatif en accessoire de mode pour promouvoir les rapports protégés auprès de leur public. En dépit des risques encourus, certains rechignent toujours à utiliser la capote. Dans leur répertoire, les trois jeunes afro-américaines valorisent le plaisir féminin, l'indépendance à l'égard des hommes et les rapports sexuels protégés. En 1994, le morceau "Waterfalls" décrit ainsi la disparition d'un homme séropositif. "Un jour il se voit dans le miroir / mais il ne reconnaît pas son propre visage / sa santé baisse et il ne sait pas pourquoi / 3 lettres l'emportent vers sa dernière demeure / Vous ne m'entendez pas."
En 1996, un nouveau traitement est mis sur le marché aux Etats-Unis. Afin de contrer le virus, il s'agit d'associer trois molécules différentes et complémentaires. Les premières trithérapies. Cette combinaison de trois antirétroviraux diminue considérablement la mortalité. Huit malades sur dix survivent. Dès lors, le sida devient une maladie chronique, avec laquelle il devient possible de vivre, à condition de prendre un traitement à vie, lourd, non sans complication, et qui ne permet pas de guérir. Faute de vaccin, la prévention joue un rôle crucial, en incitant à l'utilisation du préservatif ou des seringues jetables pour les toxicomanes. Il faut alors convaincre les autorités d'organiser des campagnes d'information massives, ce qui ne va pas sans mal, car les milieux traditionalistes s'y opposent, au nom de la décence. "Halte au sida, les capotes sont là."
Alors qu'une
rumeur insistante prétendait que les Africains-Américains ne pouvaient
pas être atteints par le Sida, le Wu-Tan-Clan, groupe de rap phare de
l'époque, tord le coup à la rumeur avec le titre "America". En France, le groupe de rock nantais Elmer Food Beat chante "le plastique c'est fantastique". Le slogan fait mouche. La chanson est adoptée par le ministère de la Santé pour une campagne en milieu étudiant recommandant le port du préservatif. Dans une veine différente, mais également très efficace, les Raggasonic chantent: "Love
C'est l'amour avec un grand "A"/ Je veux bien le faire tous les jours / Mais il court, il court le SIDA / Et veut me couper le parcours / A toutes les maîtresses et les amants qui se la donnent
/ Il ne faut pas que ça cesse, mais il pourrait y avoir maldonne / Ecoute mon pote / Même si personnellement tu n'aimes pas ça / Mets une capote / Tu verras finalement c'est mieux comme ça".
En France, en 1992 sortent sur les écrans "Les nuits fauves" de Cyril Collard, un film manifeste qui fait du réalisateur le porte-parole involontaire de la génération sacrifiée des années sida. Avec trois millions d'entrées le film est un succès. "Là-bas / les nuits fauves" .
Un premier sidaction se tient en 1994. Cette même année sort Philadelphia. Dans le film de Jonathan Demme, Tom Hanks incarne un malade du sida. Pour l'occasion, Bruce Sprigsteen compose et interprète"Streets of Philadelphia". Il y décrit la déambulation d'un malade dans une ville hostile. "J'étais meurtri et blessé et ne pouvais dire ce que je ressentais / J'étais méconnaissable / J'ai vu mon reflet dans une vitre, je ne reconnais pas mon propre visage / Oh mon frère, vas-tu me laisser dépérir? Dans les rues de Philadelphie".
Le sida sévit avec virulence sur le continent africain en raison de la combinaison de plusieurs facteurs comme le coût exorbitant des traitements antirétroviraux pour des populations pauvres, les discours hostiles à l'utilisation du préservatif tenus par le pape lors de voyage sur le continent, enfin le tabou entourant une maladie considérée comme honteuse. En dépit des discours apaisants, la communauté internationale a toléré cette situation sans apporter l'aide indispensable pour contrer l'épidémie. En cela, le Sida est bien une maladie politique, dont la dimension raciste ne fait aucun doute. Franco, grand maître de la rumba congolaise, compose "Attention na sida", un titre fleuve dans lequel il interpelle directement son auditoire. La dimension pédagogique du morceau est évidente.
C°: 40 ans après les premiers cas identifiés, le Sida n'a pas disparu. 38 millions de personnes vivent avec le VIH et 700 000 en meurent chaque année. (8) La désinformation continue de sévir et les contaminations se poursuivent. Au total, depuis le début des années 1980, plus de 40 millions de personnes sont décédées des suites de maladies liées au au Sida.
Notes:
1. L'origine du Sida. Le virus immunodéficience humaine serait une mutation du VIS, un virus présent chez certains singes d'Afrique. La contamination s'expliquerait par des accidents de chasse ou la consommation de viande singes. Le premier signe d'infection de l'homme par le VIH est repéré en 1959 à Kinshasa.
2. A la fin des années 1970, l'organisation des première gay pride, l'apparition de clubs comme le Palace puis la dépénalisation de l'homosexualité en 1981, suscitent un grand espoir pour les homosexuels français. Ce vent de liberté est cependant stoppé net par l'apparition du Sida.
3. Un contentieux oppose un temps les médecins de l'Institut Pasteur à l'équipe du biologiste américain Bob Gallo à propos de l'antériorité de la découverte du VIH. En 1997, un accord reconnaît finalement la victoire des chercheur français. Montagnier et Barré-Senoussi reçoivent le prix Nobel de médecine en 2008.
4. Toutes les personnes séropositives ne sont pas atteintes immédiatement du Sida, le stade ultime de la maladie. Les hommes représentent encore 90% des cas, mais de plus en plus de femmes sont elles aussi touchées. Les malades scrutent avec anxiété la chute des cellules T4. Au dessous de 200, le corps du patient ne peut plus défendre le corps contre des maladies opportunistes.
5. En 1993, une capote géante disposée sur l'obélisque de la place de la Concorde permet de médiatiser la lutte contre le Sida.
6. Dans leurs compositions, certains artistes pleurent parfois la perte d'êtres chers. C'est le cas d'"In this life" de Madonna ou encore "Boy blue" de Cindy Lauper.
7. Line Renaud est à cet égard une pionnière puisqu'elle crée, dès 1985, l'Association des artistes contre le sida (AACS). L'amitié bien connue de Line pour Jacques Chirac donnera à sa lutte un poids supplémentaire. En 1990 se monte également l'association Sol en si, dont le but est d'aider les enfants de parents séropositifs. De nombreux chanteurs, parmi lesquels Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Francis Cabrel, Alain Souchon et Zazie, apporteront une assistance significative à cette association.
8.
Aujourd'hui en France, près de 175 000 personnes vivent avec le VIH.
Environ 5000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année, dont
13% de jeunes de moins de 25 ans.
Sources:
- Bill Brewster & Frank Broughton: "Last night a DJ saved my life", Le Castor Astral, 2017
- Matthieu Stricot: "De l'angoisse à la la lutte, une histoire du sida", CNRS le journal, 23/06/2021.
- "Sida, quand les artistes s'engagent", Toute la culture, 1/12/2010
- "Le sida", podcast Mécaniques des épidémies diffusé sur France culture, 19/7/2022.
- Playlist de Télérama:"le sida dans la chanson", 2/7/2008
- La Case du siècle: "les années sida, à la mort, à la vie", documentaire de Lise Baron diffusé sur France 5 le 26/3/2023.