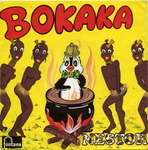Ces gardiens attentifs de nos références historiques nationales se sont dotés d'un groupe Facebook où il est possible de signer une pétition "Pour promouvoir et défendre l'Histoire de France et son enseignement dans l'Instruction Publique". Le Collectif "Notre Histoire c’est notre Avenir" insiste avec un slogan qui claque: "Louis XIV, Napoléon, c'est notre Histoire, pas Songhaï ou Monomotapa." Suit une revue de presse d'articles choisis où l'on peut lire les arguments ineptes du collectif repris par des journalistes qui ont sans doute bien mieux à faire que de se pencher sur les programmes scolaires. Tous ceux qui considèrent que "l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire", nostalgiques du bon temps des colonies, trouveront sans doute d'excellentes raisons d'aller signer la pétition. D'autres, dont nous sommes, se réjouissent de l'introduction dans nos programmes de l’histoire des civilisations africaines ou indiennes (10% du programme. C'est sans doute encore trop...).
La meilleure réponse à apporter à tous ces grincheux consiste sans doute à s'intéresser à l'histoire des royaumes médiévaux africains comme celui de Soundiata Keita, empereur du Mali.
Le vaste empire de Sundjata Keita s'étendait du Sénégal à l'ouest jusqu'au centre du Niger à l'est et du centre du Sahara au nord au sud de la Côte d'Ivoire. Cet espace prospère fut dirigé pendant plusieurs centaines d'années par des souverains puissants dont nous avons gardé le souvenir grâce aux djeli, plus connus sous nos latitudes sous le nom de griots.
Le Mali se situe au point de rencontre des grandes routes caravanières qui reliaient l'Afrique du nord au reste du continent. Ce commerce qui reposait autrefois sur les échanges d'or et d'esclaves contre des marchandises, a favorisé le développement de villes comme Tombouctou, Gao ou Djenné.
* La légende de Soundiata Keita.
C'est au XIIIème siècle que le petit royaume du Mandé (ou Mali) prend son essor. L’histoire de Soundiata Keïta est essentiellement connue par l’épopée racontée de génération en génération jusqu’à nos jours par les griots, et ainsi analysée par Seydou Camara : « Cette « épopée » aux tonalités légendaires est un mélange de souvenirs réels et de motifs de conte ; c'est, autrement dit, une construction littéraire qui évoque l'histoire locale parasitée par le thème universel du héros classique. »
Naré Maghann Konaté, le père de Sundjata, était un souverain mandingue, à la tête d'un petit royaume. Un chasseur lui affirma qu'une femme laide lui donnerait un fils qui deviendrait un grand souverain. Le monarque se souvint de la prophétie lorsqu'on lui présenta une femme hideuse, Sougoulou Konté. Cette nouvelle épouse lui donna un fils: Sundjata Keïta.
Malingre, le petit garçon éprouvait des difficultés pour marcher. Ses jambes, molles, se dérobaient sous lui. Infirme, il devait donc ramper, arc-bouté sur ses bras. A quatre ans, il ne savait toujours pas marcher. Pourtant, la prédiction affirmait qu'il deviendrait un jour un grand roi.
La mère de Soundiata, Sougoulou Konté, fut prise en grippe par une des autres épouses du père de Soundiata. Cette Sassouma Berte avait juré la perte de la mère et de son rejeton. Or, le fils de Sassouma, Dankaran Toumani Keita, accède au trône à la mort de son père, en 1218. La vie devient alors un véritable enfer pour Soundjata qui n'a d'autre choix que de s'exiler au royaume de Mena. Entre temps, un forgeron lui a donné une barre de fer, qui lui permet enfin de se redresser et de marcher normalement (Sundjata a alors 7 ans).
Pendant ce temps, Soumaoro Kante, roi du Sosso, ravage les terres du Mande et menace directement le royaume mandingue. Il tient la soeur de Soundjata captive, ainsi que le griot de la famille. Le demi-frère de Soundiata, Dankaran Toumani Keita, qui règne théoriquement, a pris la fuite après une déroute contre Kanté. Soundjata fait alors figure de sauveur et de libérateur du Mandé. Une cohorte d'émissaires se rend à Mena et le convainc de libérer son pays du joug du tyran, qui pressure et exploite le Manden depuis 3 ans. La popularité de Soundjata inquiète Kante; d'autant plus que des sorciers lui ont affirmé "ton vainqueur naîtra au Mali". Mais, Soumaoro, familier des forces occultes, disposait de pouvoirs surnaturels qui le rendaient insensible aux flèches. En retour, Soundjata sait aussi pouvoir compter sur sa soeur, Djegue. Contrainte de coucher avec Soumaoro, elle perce le secret de l'invincibilité du roi du Sosso. Pour annuler ses pouvoirs, il faudrait ainsi le toucher au talon avec une flèche confectionnée à partir d'un ergot de coq blanc.
A la suite d'une rébellion des Mandé, Kante entend en finir et se lance à l'assaut de ses sujets récalcitrants. Soundjata s'emploie alors à lever une armée qui comprend notamment Fakoly Kumba (un des aïeux de Tiken Jah Fakoly) l'ancien chef de son armée. Il reproche notamment à Kanté d'avoir enlevé son épouse. Les deux armée s'affrontent lors de la bataille de Kirina, en 1235. Soundjata vise son adversaire avec la flèche spéciale, annulant aussitôt tous ses pouvoirs de magicien. Certains racontent que le tyran disparut instantanément, d'autres expliquent qu'il se réfugia dans les montagnes de Koulikoro. Par vengeance, Soundjata ravagea le Sosso, coeur du royaume de son adversaire. Soundiata prit alors les rênes de l'empire du Mande dont il étendit considérablement les frontières.
L'empire du Mali (du 13ème au 17ème siècle) s'étendait du sud du Sahara jusqu'à la côte atlantique. Il a pour coeur la vallée du Niger. Les principales villes sont Niani, en pays malinké, Djenné, grand carrefour commercial et les trois étapes sahariennes de Oualata, Tombouctou et Gao. Un empire si prestigieux que son nom sera d’ailleurs repris en 1960, lorsque le pays devient indépendant.
* L'histoire.
Après l'éclatement de l'empire du Ghana, le petit royaume soninke du Sosso, gouverné par Soumaoro Kante, étend sa suzeraineté sur toute la région comprise entre les fleuves Sénégal et Niger, devenant un des plus puissants de l'Afrique de l'ouest. Il tente d'abord de passer des alliances avec les petits souverains mandingues à la périphérie de son territoire. En vain, ces derniers le méprisent du fait de son appartenance à la caste inférieure des forgerons. Désormais, Kanté sème la terreur dans le pays mandingue. En 1224, il entreprend une importante campagne afin d'annexer le Mandé. Il attaque notamment un petit royaume fondé dans la région du haut Niger par le clan des Keita.
Il met alors en fuite le souverain Dankaran Touman, frère de Soundjata Keita, alors en exil à Méma, près du lac Debo. Ce dernier, appuyé par plusieurs souverains des royaumes environnants, finit par prendre les armes contre Kanté. De nombreux affrontements opposent alors les deux armées. Après la défaite de Kankignè, Soundjata se venge en triomphant à la bataille de Kirina, en 1235. Kanté capitule et Soundjata s'impose alors à la tête de l'empire du Mali.
Après la reddition de Kanté, Keïta annexe le royaume du Ghana, exsangue. Il prend le titre de mansa ("chef suprême"). Durant son règne, de 1235 à 1255, il réussit à unifier tous les clans malinké du Mandé au sein d'un seul et unique royaume, avec Niani pour capitale. La prospérité de l'empire repose notamment sur l'extraction de l'or (les mines du Bouré paraissaient inépuisables), permettant un commerce florissant. La stabilité de l'empire est propice au trafic caravanier qui reprend son essor. Du nord provient le sel, le cuivre, les tissus, ainsi que les produits manufacturés venus d'Europe. Du sud partent les épices, l'ivoire, la kola, l'or et les esclaves. Dans le domaine agricole, l'empire du Mali développe bientôt la culture du coton et de l'arachide.
* Les successeurs de Soundjata
Son fils Mansa Oulé, qui règne de 1255 à 1270, étend l'empire vers l'ouest, jusqu'à l'océan Atlantique. Mais, ses héritiers se disputent son trône qui échoie finalement à Sakoura, un esclave affranchi (1285-1300). Musulman, il entreprend un voyage à la Mecque. C'est au retour de ce pélerinage qu'il est assassiné par des pirates. Les Keïta récupèrent alors leur trône. Abou Bakari II, puis Kankan Moussa. Ce dernier accède au pouvoir en 1312. Il soumet les touaregs du nord. Musulman pratiquant, il se rend en pélerinage à la Mecque en 1324, escorté par une caravane regorgeant d'or. De retour dans son empire, Kankan appelle à sa cour de nombreux lettrés maghrébins qui contribuent en retour à la renommée de leur protecteur. Tombouctou, où Moussa fait construire la mosquée Djingareiber, devient ainsi un véritable centre intellectuel, prospère grâce à l'intensité du trafic caravanier. L'empire du Mali intègre politiquement des populations de nombreuses cultures différentes unifiés sous une même administration décentralisée: Maures et Touaregs sahariens, peuples de la Savane tels que les Wolofs, les Mandingues, les Soninkés, les Songhaïs et les Dogons.
Les querelles de succession et les attaques des Mossis, des Touaregs et surtout des Songhaïs entraînent le déclin de l'empire au XVème siècle. Mais son prestige reste intact à travers les siècles. Surtout l'épopée de Sundjata Keita continue d'être rapportée par les griots.
 Détail de l'atlas dit "catalan d'Abraham Cresques (1375). Ce portulan montre le "Musse Melly" (Mansa du Mali) seigneur des nègre de Guinée" (avec couronne, sceptre, globe et trône d'or). La carte représente les richesses de l'empire du Mali.
Détail de l'atlas dit "catalan d'Abraham Cresques (1375). Ce portulan montre le "Musse Melly" (Mansa du Mali) seigneur des nègre de Guinée" (avec couronne, sceptre, globe et trône d'or). La carte représente les richesses de l'empire du Mali. * Une société hiérarchisée.
Dans l'empire domine la civilisation malenke ou mandingue (celle du Mandé, la province d'origine de Sundjata). Chez ces derniers, un système de castes organise la société, autour de 3 grandes catégories:
- Les horon sont les nobles. Représentants des fondateurs de l'empire et de leurs alliés, souvent cultivateurs, chasseurs ou commerçants, ce sont eux qui dirigent la communauté;
- les jon (les captifs) qui sont généralement descendants d'esclaves affranchis;
- Les niamakala ou gens de castes se divisent en numu (forgerons), garanké (coordonniers) et djéli (griots). Dans le cadre de cet article, ce sont bien sûr ces derniers qui vont retenir notre attention.
Les griots jouent un rôle fondamental dans la société mandingue. Leur statut se transmet de génération en génération. Détenteurs de la mémoire et de la tradition, ils restent les garants du bon fonctionnement de la communauté. Ils font ainsi office de conservateurs en tant qu'uniques dépositaires de la généalogie des familles, dans une société orale (en Afrique de l'ouest, l'enseignement et l'histoire se transmettaient à l'oral ce qui fit dire à Hampâté Bâ qu'en "Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle."). Ils constituent alors la clef de voûte de la société mandingue. D'ailleurs, au Mali, les griots sont connus sous le nom de djeli ("le sang"). Comme le signifie le terme, le djeli représente le "sang" du corps social. Ce personnage, attaché au prince ou aux hauts dignitaires du régime, connaît la jurisprudence, la constitution. Il joue aussi un rôle de précepteur auprès des enfants. C'est lui qui mémorise et transmet l'histoire, lui qui chante les louanges et les hauts faits des familles princières, auxquelles il sert aussi de porte-parole.
Les griots jouent un rôle fondamental dans la société mandingue. Leur statut se transmet de génération en génération. Détenteurs de la mémoire et de la tradition, ils restent les garants du bon fonctionnement de la communauté. Ils font ainsi office de conservateurs en tant qu'uniques dépositaires de la généalogie des familles, dans une société orale (en Afrique de l'ouest, l'enseignement et l'histoire se transmettaient à l'oral ce qui fit dire à Hampâté Bâ qu'en "Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle."). Ils constituent alors la clef de voûte de la société mandingue. D'ailleurs, au Mali, les griots sont connus sous le nom de djeli ("le sang"). Comme le signifie le terme, le djeli représente le "sang" du corps social. Ce personnage, attaché au prince ou aux hauts dignitaires du régime, connaît la jurisprudence, la constitution. Il joue aussi un rôle de précepteur auprès des enfants. C'est lui qui mémorise et transmet l'histoire, lui qui chante les louanges et les hauts faits des familles princières, auxquelles il sert aussi de porte-parole.
* L'épopée de Soundjata chantée par les musicens.
Rien ne se décide sans eux. Médiateurs, ils se chargent souvent de régler les conflits et jouent fréquemment le rôle d'intermédiaire entre le souverain et ses sujets. Bref, ils jouent un rôle de ciment social fondamental. Sa parole, chantée, souvent accompagnée d'instruments, fait autorité. Sa maîtrise du verbe est sans égale (la qualité des métaphores utilisées permet ainsi de mesurer le talent du griot). Les jelys seraient apparus à l'époque de Sundjata Keïta. Ce dernier ne sépare jamais de Balla Fasséké, son griot attitré. Jusqu'au XVIIIème siècle, les griot jouent et chantent surtout pour les nobles, tout en se rendant parfois dans les villages. A partir de cette époque, ils se tournent vers un public plus populaire, participant par exemple à des événements particuliers (naissance, mariage, funérailles). Ceux pour qui ils chantent leurs font des présents qui constituent leurs ressources. Aujourd'hui, le rôle du griot s'est banalisé et a perdu de son prestige. Dans les villes, ils deviennent souvent des artistes professionnels utilisant des instruments modernes.
Les griots sont aussi des musiciens qui s'accompagnent de la kora, du ngoni, du balafon ou du xalam. Dans leurs morceaux, ils rappellent la genèse de l'empire mandingue, les hauts faits des puissants auxquels ils restent attachés. De nombreuses chansons modernes louent Soundiata et narrent ses exploits, faisant du personnage le symbole de l'unité du mandingue, et par extension de l'Afrique. Ci-dessous, nous avons sélectionné quelques morceaux dont le somptueux morceau "Soundiata (l'exil)" interprété par Mory Kanté avec le rail Band en 1975. Ce joueur de kora guinéen appartient à une prestigieuse lignée de griots. Dès l'enfance, il acquiert une grande renommée en jouant dans les fêtes de quartier et les mariages. Il apprend alors à jouer de la kora auprès du grand maître malien Batourou Sékou Kouyate. En 1971, il intègre le rail band de Bamako en tant qu'instrumentiste, avant d'en devenir le chanteur lorsque Salif Keïta quitte le groupe.
Sources:
- La documentation photographique n°8075: "histoire de l'Afrique ancienne", 2010.
- L'émission du Dessous des Cartes consacrée au Mali.
- L'Afrique enchantée du 11/07/ 2006: "le héros".
- Article de Wikipédia sur Sounjata Keita.
- Dossier du magazine Géo sur le Mali (impossible de retrouver la date).
- "Les musiciens du beat africain", collection Compact, Bordas.
- "Le petit atlas des musiques du monde", éditions du Panama, 2006.
- Seydou Camara: "La tradition orale en question", Cahiers d'études africaines, 1996, p770.
Liens:
- CVUH: "Virer l'Afrique de l'histoire de France, il paraît que C dans l'air du temps". La réplique de trois membres du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire: Laurence De Cock, Suzanne Citron, Jean-Pierre Chrétien. Auteur du dernier numéro de la documentation photographique consacré à "l'histoire de l'Afrique ancienne", dont la lecture ferait le plus grand bien à tous ceux qui pensent que l'histoire du continent débute avec la conquête coloniale.
- Mediapart: "Les réacs au piquet!"


![bokassa[1] par guisso2](https://farm3.static.flickr.com/2236/2282832667_efb75c7e49.jpg)